Le plus naturel, c’était de se fier directement à ses sens. À sa vue, bien sûr : si votre caleçon était blanc ce matin et marron le soir, vous pouvez en déduire qu’il a du se passer quelque chose entre-temps. Mais également, et cela par un mécanisme bien plus archaïque, à son odorat. L’évolution nous a gratifié de cette disposition à nous éloigner spontanément des traces de matière organique en état de putréfaction. Une partie des bactéries jouant un rôle dans ce processus de décomposition sécrètent des molécules volatiles, que nous percevons finalement comme des « mauvaises odeurs ». Les récepteurs olfactifs qui les détectent étant directement câblés sur les mécanismes d’aversion, le but en est notamment de nous décourager instinctivement de consommer de la nourriture avariée [3]. La sueur est composée principalement d’eau, mais également de molécules minérales et organiques (de lactate, urée, mais aussi dans certaines zones du corps, de protéines et lipides). L’odeur « de transpiration » ne provient en fait pas véritablement de ces composés-là, mais de ceux rejetés par certaines des bactéries qui s’en nourrissent. Elle provoque donc chez nous une réaction similaire à celle que l’on a lorsque l’on est au contact de pourriture, bien que dans ce cas-ci cela ne manifeste pas vraiment la présence d’un danger.
Mais tout ceci a ses limites et nos sens ne peuvent pas toujours nous permettre de détecter la présence d’agents infectieux. On suppose alors implicitement que, depuis la dernière fois que l’on a lavé la chose en question, ceux-ci s’y sont déposés de façon continue dans le temps, et qu’il suffit donc de déterminer une fréquence de lavage adéquate pour éviter une accumulation problématique de ces germes. Et cela correspond bien aux questions que l’on se pose lorsque l’on se demande si ça vaut le coup de mettre un vêtement dans le panier à linge sale : Est-ce qu’il y a des tâches ? Est-ce qu’il sent mauvais ? Cela fait depuis combien de jours que je le porte ?
Les pieds propres, les mains sales
On a donc identifié les différents « jauges » dont on dispose pour évaluer dans quelle mesure quelque chose est salubre ou insalubre. En partant de l’hypothèse que l’on pourrait en extraire des mesures quantifiables et objectives, encore faudrait-il, pour chacun d’eux, déterminer un seuil : le niveau au-delà duquel on bascule de l’état propre à l’état sale. Si l’on s’en tient à cette idée que quelque chose est sale à partir du moment où il a tendance à accroître le risque d’infection chez les personnes qui en sont au contact, il est naturel de poser la question à ceux qui possèdent une expertise sur cette problématique, à savoir l’autorité médicale. Le problème serait alors étudié selon la méthode scientifique, donc en toute rigueur l’avis des médecins spécialistes du sujet devrait être unanime, indépendant de leur niveau de vie, de leur éducation ou plus largement de leur culture.
Notamment, ils nous recommanderont vivement de nous brosser les dents au moins deux fois par jour, de nous laver les mains après être allé aux toilettes, avant chaque repas, après avoir pris les transports en commun,… Mais par contre, cela sera probablement dur de trouver un médecin qui vous assurera que le fait de continuer à porter le t-shirt encore dégoulinant de sueur de votre footing de la veille pourrait être nuisible pour votre santé ou celle des personnes qui vous entourent. Et pourtant, autour de vous n’importe qui estimera que c’est sale. Mais vous pouvez aller dîner chez des amis, et ne pas passer par la salle de bain pour vous y laver les mains, sans que ceux-ci ne vous jettent des regards dégoûtés. Alors que d’un point de vue sanitaire, ce comportement présente indiscutablement plus de risques. C’est ce genre de décalage qui me fait penser qu’il y a une forte composante culturelle dans l’établissement de ces normes. Car comme je le disais plus haut, ces règles d’hygiène que l’on a acquis durant notre enfance, ce n’est ni notre médecin traitant, ni le ministre de la santé, ni un expert de l’OMS qui nous les ont dicté. Ce sont nos parents, nos amis, nos camarades de classes… et eux-même les avaient appris de leur entourage.
À la chasse aux odeurs
Pour s’en convaincre, il faut essayer de s’extirper de son contexte culturel, en s’intéressant par exemple à ce qui se fait ailleurs, ou à ce qui se faisait avant. Si vous en discutez avec vos parents ou grands-parents, vous comprendrez qu’il y a à peine un demi-siècle ces normes étaient déjà bien différentes. La douche quotidienne n’était pas généralisée et le déodorant n’était qu’un gadget pour bourgeois. Encore quelques décennies en arrière, le linge se lavait à la main et cela représentait une grosse part du travail domestique – ce n’était donc pas envisageable de changer de chaussettes chaque jour. Et même sans remonter à l’époque où il n’y avait pas d’égout, où le système de gestion des ordures ménagères était encore très précaire (voire inexistant) et où les rues étaient jonchées de déchets, il est clair que nos ancêtres ont baigné pendant longtemps dans des environnements bien plus odorants qu’aujourd’hui. C’est d’ailleurs toujours le cas dans beaucoup d’endroits du monde, et pour autant, ces gens ne respirent pas par la bouche toute la journée.
Car l’odeur n’est en fait qu’une représentation mentale. L’intensité avec laquelle on la perçoit, comme le caractère désagréable/agréable/neutre qu’on lui associe, dépend de tout un tas de facteurs et sera variable d’une personne à une autre. On peut notamment constater que, pour le sens olfactif comme pour les autres, on va réussir à s’habituer aux stimuli auxquels on est régulièrement exposé, jusqu’à parfois ne même plus les percevoir. Si j’ai bien compris, cela découle de deux mécanismes. L’un, au niveau du système limbique : lorsque l’on a déjà été exposé de nombreuses fois à une odeur, le stimulus n’est plus connoté émotionnellement – notre cerveau intégrant le fait qu’il ne manifeste pas la présence d’un danger. Elle perd donc progressivement son caractère aversif et prend moins de place dans notre champ attentionnel. L’autre, au niveau des organes sensoriels : après avoir été exposé quelques minutes à une odeur, les récepteurs olfactifs sont saturés – ils n’envoient plus de signal au cerveau pour lui communiquer sa présence [4]. Typiquement, lorsque vous vous réveillez le matin vous ne sentez pas d’odeur, car vous êtes baignés dedans depuis plusieurs heures. Si vous sortez de votre chambre quelques instants, en revenant vous remarquerez cette fois qu’il y en a une, mais ce ne sera pas forcément très désagréable. Par contre si votre coloc débarque, il se ruera vers la fenêtre pour aérer.
Lorsque l’accès à l’eau courante s’est généralisé dans les ménages, que la machine à laver est apparue, le coût économique de l’hygiène a considérablement chuté. Naturellement, les normes sociales associées sont devenues de plus en plus rigides, et dans un premier temps tout cela représentait indiscutablement un progrès en termes de santé publique. Mais le fait que l’on se lavait plus fréquemment impliquait qu’il y avait de moins en moins d’odeurs corporelles dans l’espace public. Dans ce contexte, notre odorat est devenu de plus en plus sensible à ce type d’émanation, et on a commencé à être importuné par certaines que l’on ne remarquait même pas avant. Notre seuil de tolérance s’abaissant, cela nous a poussé à nettoyer nos habits et notre corps encore plus souvent, avec de nouveau pour conséquence un accroissement de notre sensibilité olfactive. Si on y ajoute le fait que, dans une société de consommation, les fabricants de cosmétiques et produits d’entretien ne se laissent pas prier pour nous proposer une gamme toujours plus large de produits nous aidant à traquer la moindre odeur, on comprend que l’on est entré dans une sorte de cercle vicieux, une course au « toujours plus propre » qui aurait pu se poursuivre indéfiniment [5].
[3] https://lejournal.cnrs.fr/articles/de-la-molecule-a-lodeur
[4] http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-est-difficile-sentir-odeur-propre-maison-1730094.html
[5] Un autre aspect qu’il aurait fallu développer un peu plus est le fait que l’hygiène a sûrement toujours joué le rôle de marqueur social, et donc qu’à la peur d’être mis en minorité s’ajoute la hantise d’être considéré comme un membre de la classe sociale du dessous. Cela devait être d’autant plus net il y a quelques siècles, lorsque les bourgeois pouvaient se permettre d’avoir un niveau d’hygiène bien meilleur que les paysans ou les ouvriers. Je pense que c’est encore un peu le cas aujourd’hui, car le budget nécessaire pour rester dans la norme de ce point de vue-là n’est pas négligeable pour les ménages les moins aisés. Donc ceux-là sont probablement d’autant plus sensibles à cette injonction de ne pas sentir qu’ils craignent d’être assimilés aux personnes de la société qui ont le moins accès à l’hygiène, c’est à dire les sans-abris.
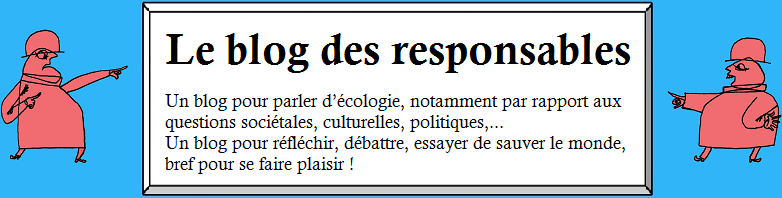
Héhé, cet article m’a fait bien rire. Je le trouve bien écrit et documenté. La réflexion est facile à suivre et poussée.
Pour ma part, j’ai réduit les shampoing à quand le besoin s’en fait sentir (après 1 mois de camping par exemple) ou bien quand je vais chez le coiffeur (fréquence entre 1 et 3 mois).
Je prends moins de douche en hiver qu’en été. Il m’arrive de ne faire que de me rincer et parfois de ne laver que les parties intimes, pieds, aiselles. J’avais même expérimenté une année à l’eau froide quand j’étais au lycée. J’attends avec impatience le jour où les douchettes feront unanimité dans les toilettes occidentaux.
Pareillement il y a des vêtements que je ne lave que si je constate une tache ou une odeur dérangeante (pantalons et pulls), sinon quoi j’ai juste instauré un roulement. Je continue de laver régulièrement le linge de corps (sous-vêtements et tee shirt).
N’utilise évidemment pas de déo, parfum… Et j’ai revu à la baisse mes exigences concernant les odeurs de transpi.
Merci pour le blogs, c’est bien cool !
J’aimeJ’aime
[J’attends avec impatience le jour où les douchettes feront unanimité dans les toilettes occidentaux.]
En attendant vous pouvez aussi utiliser une bouteille d’eau, c’est un peu moins pratique mais ça marche aussi bien ! Et pis pour chez soi c’est assez simple à installer une douchette (même si on est pas un expert en plomberie !) Et ça se trouve très facilement sur internet ou aux magasins type Castorama, Leroy Merlin, etc…
[Merci pour le blogs, c’est bien cool !]
Merci à vous pour ces retours 🙂
J’aimeJ’aime
Très éclairant et complet, merci beaucoup! Je ne manquerai pas de consulter régulièrement votre blog!
J’aimeJ’aime
Très intéressant article. Je me suis posé exactement ce questionnement cet hiver. Ayant acheté des tee shirt en mérinos (qui ne retiennent pas l’odeur de sueur), je me suis amusée à porter le tee shirt une semaine au travail. Bien qu’il n’ai pas de taches, qu’il ne sente rien et que je me lave tous les jours, mes collègues trouvaient que forcément ll était sale car en relation avec les transports, la poussières, les squames… Alors je continue à le porter plusieurs fois mais pas plusieurs jours d affilé !
J’aimeJ’aime
Excellent article.
Les notions de « propre » et de « sale » sont des notions modernes, dans l’antiquité on utilisait les notions (religieuses) de « pur » et « d’impur » .
Bien qu’oubliées par la pensée moderne, il est possible (votre article le laisse penser) que ces notions soient toujours efficientes dans l’inconscient des modernes.
J’aimeJ’aime