La représentation de l’échiquier politique selon un axe gauche-droite ne semble aujourd’hui plus forcément pertinente pour mettre en évidence les véritables clivages idéologiques au sein de la société française. Partant de ce constat, j’ai travaillé sur une analyse graphique en modélisant cet espace selon deux axes – ceux que je propose portant, pour l’un, sur les questions économiques, et pour l’autre, sur les questions de société. À partir de là, j’ai tracé plusieurs diagrammes, que vous pouvez consulter en téléchargeant ce document pdf. En complément, j’ajoute ici quelques commentaires pour expliquer un peu plus en détails ce que j’ai voulu mettre en évidence.
Avant de commencer, il faut déjà mettre deux-trois choses au clair. En dessinant ces diagrammes, je me suis efforcé de laisser le moins possible transparaître mon opinion, d’être le moins “subjectif” possible. Mais s’agissant de politique, l’objectivité absolue n’est pas atteignable et, que je le veuille ou non, la façon dont je présente les choses dépend forcément dans une certaine mesure de mes convictions. C’est peut-être plus évident pour le texte qui suit puisqu’il est d’avantage question d’analyse et d’interprétation. Bref, ce que je veux dire par là c’est qu’il faut toujours s’efforcer de rester critique par rapport à ce que je dessine et ce que j’écris, et garder à l’esprit qu’ici quasiment tout est contestable. Et d’ailleurs s’il y a un formulaire de commentaires au bas de la page, c’est justement parce que je compte sur vous pour venir le contester !
 La nécessité de représenter l’espace politique selon deux dimensions découle souvent du constat que le modèle à un seul axe gauche-droite possède de grosses lacunes. D’une part, parce que les mots “gauche” et “droite” ne désignent finalement rien d’autre que la position des fauteuils au palais Bourbon. On leur a donné un jour une signification en termes d’idéologie politique, mais rien ne les empêche d’évoluer dans le temps. Rien ne nous empêche de les redéfinir chacun à notre sauce, et on conçoit facilement que le jour où on leur aura donné chacun un sens différent, cela ne servira plus à rien de les employer. D’autre part, car ce modèle est de par sa nature très limité, étant donné qu’il suppose que l’on puisse représenter selon une seule dimension une infinité de positionnements sur des questions politiques qui peuvent être parfois totalement indépendantes. Une conséquence de tout ça est que l’on va se retrouver à situer au même bord des personnes qui n’ont presque rien en commun. Et inversement, on en placera certains en opposition frontale malgré qu’ils soient d’accord sur l’essentiel.
La nécessité de représenter l’espace politique selon deux dimensions découle souvent du constat que le modèle à un seul axe gauche-droite possède de grosses lacunes. D’une part, parce que les mots “gauche” et “droite” ne désignent finalement rien d’autre que la position des fauteuils au palais Bourbon. On leur a donné un jour une signification en termes d’idéologie politique, mais rien ne les empêche d’évoluer dans le temps. Rien ne nous empêche de les redéfinir chacun à notre sauce, et on conçoit facilement que le jour où on leur aura donné chacun un sens différent, cela ne servira plus à rien de les employer. D’autre part, car ce modèle est de par sa nature très limité, étant donné qu’il suppose que l’on puisse représenter selon une seule dimension une infinité de positionnements sur des questions politiques qui peuvent être parfois totalement indépendantes. Une conséquence de tout ça est que l’on va se retrouver à situer au même bord des personnes qui n’ont presque rien en commun. Et inversement, on en placera certains en opposition frontale malgré qu’ils soient d’accord sur l’essentiel.  Avec deux dimensions, on se donne déjà les moyens de décrire cet espace de manière un peu plus fine. En veillant à ce que les axes soient définis avec des mots dont la terminologie est « intangible » – dans la mesure où ils sont directement associables à des débats politiques et qu’on ne peut donc pas les redéfinir à l’infini – on s’assure que l’on est bien tous en train de parler plus ou moins de la même chose. Le modèle que je propose consiste en deux axes, un axe vertical sur l’organisation de l’économie, et un axe horizontal sur l’organisation de la société, comme défini page 1 du pdf. On peut également les interpréter comme des « échelles » de liberté économique et libertés individuelles (page 2). Ils sont assez comparables à ceux proposés par le libertarien David Nolan ou plus récemment en France par Thomas Guénolé [1].
Avec deux dimensions, on se donne déjà les moyens de décrire cet espace de manière un peu plus fine. En veillant à ce que les axes soient définis avec des mots dont la terminologie est « intangible » – dans la mesure où ils sont directement associables à des débats politiques et qu’on ne peut donc pas les redéfinir à l’infini – on s’assure que l’on est bien tous en train de parler plus ou moins de la même chose. Le modèle que je propose consiste en deux axes, un axe vertical sur l’organisation de l’économie, et un axe horizontal sur l’organisation de la société, comme défini page 1 du pdf. On peut également les interpréter comme des « échelles » de liberté économique et libertés individuelles (page 2). Ils sont assez comparables à ceux proposés par le libertarien David Nolan ou plus récemment en France par Thomas Guénolé [1].
Il est déjà intéressant de se demander où est-ce que l’on situerait le clivage droite-gauche dans ce plan, dans son sens qui semble le plus largement partagé aujourd’hui (page 3). Je pense que, du moins dans l’inconscient collectif, la gauche se définirait en premier lieu par son positionnement dans le débat économique, militant pour une économie plus régulée. La droite se définit plutôt par son positionnement sur les questions de société, revendiquant une société plus normée. Notamment, on aura tendance à dire de quelqu’un qu’il est très “à gauche” s’il est très “régulateur”, qu’il est très “à droite” s’il est très “normatif”. En conséquence, les libéraux s’opposant à la gauche, ils ne pouvaient être que de droite. Les libertaires s’opposant à la droite, ils ne pouvaient être que de gauche. Ainsi, ceux qui étaient à la fois régulateurs et libertaires se sont présentés comme la vraie gauche, et ceux qui étaient en même temps libéraux et normatifs comme la vraie droite. Il reste donc deux quadrants pour lesquels le positionnement selon ce clivage est moins net. On peut dire que ceux qui s’y trouvent sont à la fois “de gauche et de droite“, ou bien “ni de gauche ni de droite”. Étant donné la tradition politique, ils doivent tout de même s’efforcer de choisir un camp, mais ils n’y sont pas aussi à l’aise que les autres.
en premier lieu par son positionnement dans le débat économique, militant pour une économie plus régulée. La droite se définit plutôt par son positionnement sur les questions de société, revendiquant une société plus normée. Notamment, on aura tendance à dire de quelqu’un qu’il est très “à gauche” s’il est très “régulateur”, qu’il est très “à droite” s’il est très “normatif”. En conséquence, les libéraux s’opposant à la gauche, ils ne pouvaient être que de droite. Les libertaires s’opposant à la droite, ils ne pouvaient être que de gauche. Ainsi, ceux qui étaient à la fois régulateurs et libertaires se sont présentés comme la vraie gauche, et ceux qui étaient en même temps libéraux et normatifs comme la vraie droite. Il reste donc deux quadrants pour lesquels le positionnement selon ce clivage est moins net. On peut dire que ceux qui s’y trouvent sont à la fois “de gauche et de droite“, ou bien “ni de gauche ni de droite”. Étant donné la tradition politique, ils doivent tout de même s’efforcer de choisir un camp, mais ils n’y sont pas aussi à l’aise que les autres.
La page 4 concerne ce que j’ai désigné comme les “thèmes prioritaires”. Une personnalité ou une formation politique qui se présente à une élection va justifier sa candidature par le fait qu’elle propose un projet différent de ceux des autres.  Concrètement, cela signifie déjà qu’elle n’apporte pas les mêmes réponses à toutes les questions qui leur sont posées. Plus de dépenses publiques ou moins de dépenses publiques ? Plus d’Europe ou moins d’Europe ? Plus d’immigration ou moins d’immigration ? Mais également qu’elle n’accorde pas la même importance à chacun de ces sujets, car forcément, il y a implicitement une hiérarchisation des priorités. D’une part, car l’objectif n’est pas seulement de se faire élire, mais également de convaincre, de peser dans le débat et de gagner du terrain idéologiquement sur les autres candidats. Le temps de parole dont chacun dispose pour s’exprimer dans les médias n’étant pas illimité, la fraction que l’on consacre à défendre son point de vue sur une question donnée sera du temps en moins pour argumenter sur une autre. D’autre part, car une fois au pouvoir il faudra transposer ces discours et ces idées (plus ou moins abstraites) en mesures concrètes. On se retrouvera confronté à des réalités, à un cadre de contrainte – notamment en terme budgétaire – et il faudra alors souvent revoir ses ambitions à la baisse par rapport à ce que l‘on avait promis pendant la campagne. En mettant l’accent sur un point plus que sur un autre, on laisse entendre qu’il s’agit d’un des dossiers sur lequel on voudra être jugé de la réussite ou non de notre mandat.
Concrètement, cela signifie déjà qu’elle n’apporte pas les mêmes réponses à toutes les questions qui leur sont posées. Plus de dépenses publiques ou moins de dépenses publiques ? Plus d’Europe ou moins d’Europe ? Plus d’immigration ou moins d’immigration ? Mais également qu’elle n’accorde pas la même importance à chacun de ces sujets, car forcément, il y a implicitement une hiérarchisation des priorités. D’une part, car l’objectif n’est pas seulement de se faire élire, mais également de convaincre, de peser dans le débat et de gagner du terrain idéologiquement sur les autres candidats. Le temps de parole dont chacun dispose pour s’exprimer dans les médias n’étant pas illimité, la fraction que l’on consacre à défendre son point de vue sur une question donnée sera du temps en moins pour argumenter sur une autre. D’autre part, car une fois au pouvoir il faudra transposer ces discours et ces idées (plus ou moins abstraites) en mesures concrètes. On se retrouvera confronté à des réalités, à un cadre de contrainte – notamment en terme budgétaire – et il faudra alors souvent revoir ses ambitions à la baisse par rapport à ce que l‘on avait promis pendant la campagne. En mettant l’accent sur un point plus que sur un autre, on laisse entendre qu’il s’agit d’un des dossiers sur lequel on voudra être jugé de la réussite ou non de notre mandat.
Revenons à l’histoire des deux quadrants qui seraient à cheval entre la droite et la gauche. Qu’est-ce qui différencie par exemple le centre-gauche du centre-droit ? L’expérience montre qu’une fois au pouvoir ils adopteront à peu de choses près les mêmes politiques – même chose entre la gauche républicaine et la droite gaulliste. Je pense qu’ils se distinguent néanmoins dans leur discours, justement par le fait qu’ils mettent la priorité sur des thèmes différents. Prenons donc les libéraux-libertaires. Ceux qui ont choisi la gauche sont d’une certaine façon des « libéraux inassumés », du fait que le libéralisme économique est plutôt associé à la droite. Ils mettront alors leur priorité sur les questions de société et s’exprimeront principalement par rapport à ces débats-là. Une fois au pouvoir, ils appliqueront des politiques libérales, mais sans en faire un motif de fierté, se défendant simplement d’un pragmatisme. Inversement ceux qui ont choisi la droite sont un peu des « libertaires honteux », ils ont plutôt tendance à mettre la priorité sur les questions économiques. On peut prendre comme exemple le débat sur le mariage pour tous en 2013. Chez les libéraux de gauche, il y avait beaucoup d’engouement et c’était un moment important de leur mandat. Mais par contre, les libertaires de droite restaient beaucoup plus discrets, pour éviter de diviser leur camp. Ceux qui ne se disent « ni de gauche ni de droite » sont à l’aise sur les deux sujets. On peut faire le même raisonnement pour les sociaux-souverainistes.
Il y a une autre chose qui me semble intéressante de relever ici et en particulier concernant la moitié “société normée”. On peut sentir que l’axe horizontal correspond en fait à deux débats relativement distincts. Car il y a d’une part, les normes plutôt associées à la nation et à l’État, et d’autre part celles relatives à une « moralité traditionnelle » et plutôt liées à l’Eglise. On constate en pratique que parmi ceux qui souhaitent plus de normes, les « catho-tradi » sont généralement plutôt libéraux sur les questions économiques, tandis que ceux qui font primer la nation sont plutôt régulateurs. C’est pour cela que j’ai appelé les premiers les “sociaux-souverainistes” et les seconds les “libéraux-conservateurs”. Chez les libertaires, on ne remarque pas vraiment de distinction puisqu’ils veulent moins de normes tout court. Mais forcément cela limite un peu l’analyse et on pourrait les dissocier en ajoutant une troisième dimension, bien sûr graphiquement cela commencerait à devenir compliqué…
Page 5 , il est question d’un certain nombre d’hommes politique (avec notamment en gras les différents présidents de la 5e République). Mes choix de positionnements sur cette matrice sont particulièrement discutables. Parmi les difficultés que l’on rencontre lorsque l’on s’essaie à ce genre d’exercice, l’une d’entre elle provient du fait qu’il y a toujours un décalage entre la façon dont les personnalités politiques se positionnent à travers leur discours et leurs programmes électoraux, et les actions qu’ils mettent en place lorsqu’ils sont au pouvoir. Pour réduire la part de subjectivité (bien qu’elle soit de toute manière inévitable) j’ai essayé de plutôt faire en fonction du premier point, de façon à ce que globalement la matrice mette d’accord le plus de monde possible.
, il est question d’un certain nombre d’hommes politique (avec notamment en gras les différents présidents de la 5e République). Mes choix de positionnements sur cette matrice sont particulièrement discutables. Parmi les difficultés que l’on rencontre lorsque l’on s’essaie à ce genre d’exercice, l’une d’entre elle provient du fait qu’il y a toujours un décalage entre la façon dont les personnalités politiques se positionnent à travers leur discours et leurs programmes électoraux, et les actions qu’ils mettent en place lorsqu’ils sont au pouvoir. Pour réduire la part de subjectivité (bien qu’elle soit de toute manière inévitable) j’ai essayé de plutôt faire en fonction du premier point, de façon à ce que globalement la matrice mette d’accord le plus de monde possible.
Prenons le cas de Mélenchon. Sur l’axe économique je l’ai positionné dans la moitié inférieure, car je pense qu’il y a un consensus autour du fait que, lorsqu’il s’exprime, il milite pour une économie plus régulée. Cependant, certains pourront voir dans son discours des contradictions qui l’obligeront, s’il est élu à la tête de l’Etat, à faire certains choix là où il peut se dispenser de trancher tant qu’il ne s’agit que de paroles. Par exemple, de mon point de vue, étant donné qu’il ne semble pas véritablement disposé à remettre en question la supranationalité, le marché unique, la monnaie unique, il ne pourra pas mettre en place une politique économique moins libérale que ce qu’ont réussi les autres gouvernements dits de-gauche qui se sont succédés ces dernières décennies [2]. Je pourrais donc en toute bonne foi le positionner dans la moitié supérieure de la matrice, mais ce serait loin de faire l’unanimité car d’autres analyseraient les choses différemment.
Les pages suivantes (6, 7, 8), il s’agit du positionnement des partis politiques en se basant sur les résultats du premier tour des dernières élections présidentielles, puisque l’on considère généralement qu’il s’agit du suffrage qui permet d’évaluer au mieux le rapport de force au sein de l’électorat. Sur les 10-15 dernières années, on peut observer une restructuration de l’espace politique de deux pôles (gauche et droite) à quatre pôles, coïncidant avec les quatre quadrants de mon diagramme – cela rejoint le constat de Guénolé. Lorsque les candidats PS et UMP/RPR avaient la quasi-certitude d’être au second tour, le nombre de candidats avait tendance à être important car les alliances et ralliements se faisaient surtout au deuxième tour. Mais lorsque trois ou quatre candidats ont des chances de s’y qualifier, chaque pôle appelle au “vote utile” et les alliances se font plutôt au premier tour.
il s’agit du positionnement des partis politiques en se basant sur les résultats du premier tour des dernières élections présidentielles, puisque l’on considère généralement qu’il s’agit du suffrage qui permet d’évaluer au mieux le rapport de force au sein de l’électorat. Sur les 10-15 dernières années, on peut observer une restructuration de l’espace politique de deux pôles (gauche et droite) à quatre pôles, coïncidant avec les quatre quadrants de mon diagramme – cela rejoint le constat de Guénolé. Lorsque les candidats PS et UMP/RPR avaient la quasi-certitude d’être au second tour, le nombre de candidats avait tendance à être important car les alliances et ralliements se faisaient surtout au deuxième tour. Mais lorsque trois ou quatre candidats ont des chances de s’y qualifier, chaque pôle appelle au “vote utile” et les alliances se font plutôt au premier tour.  On peut d’ailleurs remarquer qu’il y avait 16 candidats en 2002 et seulement 11 en 2017 (et même 10 en 2012).
On peut d’ailleurs remarquer qu’il y avait 16 candidats en 2002 et seulement 11 en 2017 (et même 10 en 2012).
Si on regarde séparément les différentes formations et la façon dont chacune se sont réorganisées, on observe qu’à chaque fois des tensions internes apparaissaient là où elles étaient à cheval sur plusieurs pôles, et que les scissions ont alors eu lieu à la frontière entre ces quadrants. À la suite de l’investiture de Hamon en 2017, les partisans libéraux du PS se sont rapprochés de Macron, dont ils se sentaient plus proches idéologiquement. Même chose parmi les électeurs plus libertaires de LR, bien qu’un peu plus tardivement étant donné que leur candidat a été pendant longtemps le grand favori de l’élection. Au FN, le divorce a véritablement eu lieu après les législatives.  Le parti, traditionnellement d’extrême droite et plutôt libéral-conservateur, avait commencé à adopter des positions de plus en plus régulatrices sur les questions économiques depuis l’arrivée de Marine Le Pen et sous l’impulsion de Florian Philippot, adoucissant dans le même temps ses positions sur les questions sociétales et leur accordant moins d’importance. Ainsi, ils commençaient à occuper un espace déserté depuis quelques temps, dans lequel se trouvaient auparavant le PCF, une partie du RPR (incarnée par Philippe Séguin), et une partie du PS (incarnée par J-P Chevènement). Mais les dissensions entre une base électorale de plus en plus populaire et souverainiste, et une base militante toujours majoritairement libérale et identitaire, ont visiblement conduit Marine Le Pen à faire demi-tour après la relative déception du second tour de 2017. Enfin, si on regarde quelques années plus tôt, les libéraux de EELV (De Rugy, Placé, Pompili) avaient également fait scission pour créer le Parti Écologiste. Et chaque fois qu’un divorce est acté, les restes de ces partis vont naturellement se rapprocher des autres formations présentes à l’intérieur de leur pôle.
Le parti, traditionnellement d’extrême droite et plutôt libéral-conservateur, avait commencé à adopter des positions de plus en plus régulatrices sur les questions économiques depuis l’arrivée de Marine Le Pen et sous l’impulsion de Florian Philippot, adoucissant dans le même temps ses positions sur les questions sociétales et leur accordant moins d’importance. Ainsi, ils commençaient à occuper un espace déserté depuis quelques temps, dans lequel se trouvaient auparavant le PCF, une partie du RPR (incarnée par Philippe Séguin), et une partie du PS (incarnée par J-P Chevènement). Mais les dissensions entre une base électorale de plus en plus populaire et souverainiste, et une base militante toujours majoritairement libérale et identitaire, ont visiblement conduit Marine Le Pen à faire demi-tour après la relative déception du second tour de 2017. Enfin, si on regarde quelques années plus tôt, les libéraux de EELV (De Rugy, Placé, Pompili) avaient également fait scission pour créer le Parti Écologiste. Et chaque fois qu’un divorce est acté, les restes de ces partis vont naturellement se rapprocher des autres formations présentes à l’intérieur de leur pôle.
La page 9 correspond aux résultats des dernières élections européennes. Etant donné que la nature du scrutin est différente,  ils n’illustrent pas le rapport de force de la même manière. Le parlement européen ayant très peu de pouvoir, les électeurs s’y intéressent beaucoup moins, se décident tardivement, votent moins en fonction des conséquences directes qu’ils souhaitent au niveau de la législation européenne, que du message qu’ils veulent transmettre à ce moment-là : “contre Macron”, “contre l’extrême droite”, “contre la fin du monde”,… Le changement de ligne du RN semble pour l’instant payant au niveau électoral. En abandonnant l’idée d’une sortie de l’euro ils ont pu rassurer la frange la plus conservatrice de l’électorat LR et gagner des voix de ce côté. Pour le moment ils gardent néanmoins l’image de parti à tendance social-souverainiste, et par habitudes électorales les classes populaires continuent de leur accorder leurs voix. Mais à terme cela semble inévitable qu’une partie commence à s’en détourner, du moins si une offre politique crédible émerge dans le cadran du dessous. Au vu du morcellement des voix des sociaux-libertaires aux européennes, tous semblent désormais s’accorder sur la nécessité de se rapprocher dans la perspective des élections de 2022. Les dernières réticences de la FI semblent aujourd’hui écartées après leur débâcle. Cette stratégie paraît d’autant plus naturelle si l’on tient compte de l’éviction brutale des figures de la ligne souverainiste-républicaine – François Cocq et Djordje Kuzmanovic – dont le positionnement idéologique semblait de toute manière beaucoup trop éloigné de celui de la base électorale de Mélenchon sur de nombreuses questions (la construction européenne, l’identité culturelle, l’autorité de l’Etat,…).
ils n’illustrent pas le rapport de force de la même manière. Le parlement européen ayant très peu de pouvoir, les électeurs s’y intéressent beaucoup moins, se décident tardivement, votent moins en fonction des conséquences directes qu’ils souhaitent au niveau de la législation européenne, que du message qu’ils veulent transmettre à ce moment-là : “contre Macron”, “contre l’extrême droite”, “contre la fin du monde”,… Le changement de ligne du RN semble pour l’instant payant au niveau électoral. En abandonnant l’idée d’une sortie de l’euro ils ont pu rassurer la frange la plus conservatrice de l’électorat LR et gagner des voix de ce côté. Pour le moment ils gardent néanmoins l’image de parti à tendance social-souverainiste, et par habitudes électorales les classes populaires continuent de leur accorder leurs voix. Mais à terme cela semble inévitable qu’une partie commence à s’en détourner, du moins si une offre politique crédible émerge dans le cadran du dessous. Au vu du morcellement des voix des sociaux-libertaires aux européennes, tous semblent désormais s’accorder sur la nécessité de se rapprocher dans la perspective des élections de 2022. Les dernières réticences de la FI semblent aujourd’hui écartées après leur débâcle. Cette stratégie paraît d’autant plus naturelle si l’on tient compte de l’éviction brutale des figures de la ligne souverainiste-républicaine – François Cocq et Djordje Kuzmanovic – dont le positionnement idéologique semblait de toute manière beaucoup trop éloigné de celui de la base électorale de Mélenchon sur de nombreuses questions (la construction européenne, l’identité culturelle, l’autorité de l’Etat,…).
Pour les partisans du Frexit, d’un point de vue comptable l’échec est cuisant. On peut imaginer que la frange de la population qui serait susceptible de constituer leur électorat a préféré continuer à donner sa voix au RN, afin de priver Macron d’une victoire symbolique, quand elle ne s’est pas abstenue. Tout reste à construire, mais paradoxalement les conditions semblent plus que jamais réunies pour voir émerger un mouvement rassemblant les souverainistes des deux rives. Car nous arrivons à la fin d’un processus où toutes les personnalités encartées dans des mouvements bien implantés dans le paysage électoral s’en sont faites évincées. Le lissage du discours du RN sur les questions économiques et sur la souveraineté risque de créer un appel d’air, tout comme l’abandon par la FI de sa stratégie plan A/plan B – qui permettait d’entretenir le flou sur ces sujets et contenter à la fois souverainistes de gauche et fédéralistes. Par ailleurs, les événements en Grèce et plus récemment en Italie et au Royaume Unis ont largement ébranlé le projet européen. Les économistes s’accordent sur la fragilité macro-économique structurelle de la zone euro et prévoient un nouvelle crise monétaire. L’émergence du mouvement des Gilets Jaunes appelle à des changements radicaux et les classes populaires semblent prendre conscience qu’ils ne pourront pas avoir lieu dans ce cadre supranational. Cependant, sortir de l’euro et de l’Union Européenne reste une perspective très anxiogène pour les français et il faudra encore du temps avant de réussir à convaincre une majorité de son intérêt à terme.
Par ailleurs,  un exercice intéressant est d’essayer de positionner sur cette matrice l’électorat, en fonction de la manière dont votent majoritairement les membres de telle ou telle catégorie professionnelle (page 10). Je n’ai pas mis de référence car il n’y aurait de toute façon pas de méthode véritablement rigoureuse pour dessiner ce diagramme. En pratique je me suis surtout basé sur les études sociologiques des dernières présidentielles en essayant de faire le lien entre les professions des électeurs et la position des candidats telles que je les avais positionné page 5. Au final, je pense que ce n’est pas si éloigné que ça de la réalité, même s’il a forcément fallu que je la joue un peu « au feeling ». J’ai également tracé un axe oblique concernant la répartition de l’électorat par âge. C’était assez net en 2017 avec, chez les 18-25 ans, 29 % pour Mélenchon contre 12 % pour Fillon,
un exercice intéressant est d’essayer de positionner sur cette matrice l’électorat, en fonction de la manière dont votent majoritairement les membres de telle ou telle catégorie professionnelle (page 10). Je n’ai pas mis de référence car il n’y aurait de toute façon pas de méthode véritablement rigoureuse pour dessiner ce diagramme. En pratique je me suis surtout basé sur les études sociologiques des dernières présidentielles en essayant de faire le lien entre les professions des électeurs et la position des candidats telles que je les avais positionné page 5. Au final, je pense que ce n’est pas si éloigné que ça de la réalité, même s’il a forcément fallu que je la joue un peu « au feeling ». J’ai également tracé un axe oblique concernant la répartition de l’électorat par âge. C’était assez net en 2017 avec, chez les 18-25 ans, 29 % pour Mélenchon contre 12 % pour Fillon,  et chez les plus de 65 ans, 39 % pour Fillon et 12 % pour Mélenchon [3].
et chez les plus de 65 ans, 39 % pour Fillon et 12 % pour Mélenchon [3].
Cette matrice rappelle un peu le diagramme réalisé par Pierre Bourdieu dans « La distinction » (page 11) [4]. Il y situait les catégories socioprofessionnelles en fonction du capital économique et du capital culturel – pour faire simple on peut associer ce dernier au nombre d’années d’étude, même si sa définition est un peu plus précise. Bien sûr, il date de 40 ans donc il serait sûrement un peu différent aujourd’hui. On peut quand même remarquer que globalement l’axe “capital économique” et mon axe vertical se recouvrent, de même que l’axe capital culturel avec mon axe horizontal (page 12). Pour dire les choses autrement,  plus on a de capital économique et plus on aura tendance à voter pour davantage de libertés économiques (et vice-versa). Plus on a de capital culturel et plus on aura tendance à voter pour davantage de libertés individuelles (et vice-versa).
plus on a de capital économique et plus on aura tendance à voter pour davantage de libertés économiques (et vice-versa). Plus on a de capital culturel et plus on aura tendance à voter pour davantage de libertés individuelles (et vice-versa).
Il y aurait de nombreuses façons d’interpréter cette concordance. Je trouve que le plus pertinent est de raisonner en termes d’intérêts matériels, en postulant que les membres d’une classe sociale donnée vont – de manière plus ou moins inconsciente – adhérer à l’idéologie qui défend leurs intérêts personnels, bien qu’étant sincèrement convaincus qu’il s’agit de l’intérêt général. Cela rejoint en fait les analyses de Marx sur la question [5]. Cela peut sembler assez intuitif et naturel qu’une économie libérale permette aux plus riches de conserver et transmettre leur patrimoine à leur descendance, tandis que dans une économie régulée les richesses matérielles seront davantage redistribuées. Par contre, le fait que plus de libertés individuelles et des institutions moins fortes soient favorables à ceux qui ont le plus de capital culturel n’apparaîtra pas forcément aussi évident pour tout le monde, ou sera, du moins, plus dur à conceptualiser. Il s’agit donc de l’idée selon laquelle ces libertés-là faciliteraient la transmission de ce type de capital, des personnes qui en possèdent le plus à leur descendance, en évitant notamment que l’État ne le « redistribue » [6].
Mais il ne s’agit probablement pas de l’analyse la plus partagée de nos jours – du moins dans les médias et parmi les intellectuels – lorsque l’on essaie d’expliquer pourquoi certains souhaitent plus de libertés individuelles tandis que d’autres demandent plus de normes et des institutions fortes. Il me semble qu’on a plutôt tendance à se complaire dans cette idée que ces divergences proviendraient simplement du fait que les personnes issues de milieux populaires et qui ont fait peu ou pas d’études n’ont pas la culture nécessaire pour savoir quelles politiques sont bonnes et quelles politiques sont mauvaises. N’ayant pas les outils pour reconnaître où serait objectivement l’intérêt général, ils se laisseraient plus facilement manipuler par des discours simplistes, populistes, démagogues, et faisant davantage appel aux émotions [7]. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces questions, mais comme vous le voyez, on entre alors dans des débats assez sensibles et sur des considérations très subjectives donc c’est peut-être mieux que l’on s’arrête là.
Mais juste pour revenir à la question du clivage gauche-droite,  je pense que tout ceci illustre bien le fait que ce modèle-là n’est plus très pertinent puisqu’il peine à faire ressortir les véritables divisions de la société française et à les laisser s’exprimer en termes politiques. Notamment, les personnalités et formations couramment positionnées sur ce clivage comme proche du centre (et qui défendraient donc les positions les plus modérées, consensuelles, voire les seules raisonnables) sont en fait largement excentrés lorsque l’on analyse l’espace politique avec ma matrice (page 3). Les dits centristes – tout comme ceux que l’on associe au centre-gauche et au centre-droit – défendent en fait généralement des positions libérales-libertaires, idéologie qui, dans mon analyse, sert les intérêts de la classe intellectuelle. On peut penser que c’est fortuit, ou bien on peut se dire qu’il s’agit tout simplement d’une des conséquences du fait que c’est celle-ci qui possède les leviers pour imposer les termes du débat.
je pense que tout ceci illustre bien le fait que ce modèle-là n’est plus très pertinent puisqu’il peine à faire ressortir les véritables divisions de la société française et à les laisser s’exprimer en termes politiques. Notamment, les personnalités et formations couramment positionnées sur ce clivage comme proche du centre (et qui défendraient donc les positions les plus modérées, consensuelles, voire les seules raisonnables) sont en fait largement excentrés lorsque l’on analyse l’espace politique avec ma matrice (page 3). Les dits centristes – tout comme ceux que l’on associe au centre-gauche et au centre-droit – défendent en fait généralement des positions libérales-libertaires, idéologie qui, dans mon analyse, sert les intérêts de la classe intellectuelle. On peut penser que c’est fortuit, ou bien on peut se dire qu’il s’agit tout simplement d’une des conséquences du fait que c’est celle-ci qui possède les leviers pour imposer les termes du débat.
Et pas seulement parce que ceux qui l’arbitrent et qui sont, au niveau médiatique, en première ligne appartiennent à cette classe sociale (journalistes, mais aussi philosophes, économistes, sociologues, essayistes,…). Mais aussi parce que c’est également le cas de ceux qui “consomment” leurs analyses et qui les font donc vivre. On trouvera par exemple beaucoup plus d’abonnés à des hebdomadaires traitant de l’actualité politique parmi les médecins ou les ingénieurs que parmi les ouvriers ou les femmes de ménage, car ces derniers tirent généralement moins de plaisir dans ce genre d’activités et s’intéressent à la politique essentiellement pendant les périodes électorales. Je pense que c’est l’une des raisons pour laquelle la presse de ligne éditoriale libérale-libertaire est, par exemple, bien plus fournie que la presse social-souverainiste (page 13) [8]. D’ailleurs, avant l’arrivée de Natacha Polony à la tête de la rédaction de Marianne et le lancement de la revue Front Populaire, celle-ci était quasiment inexistante.
On peut bien sûr trouver de nombreuses limites à toutes ces analyses graphiques. Notamment, concernant l’étude sociologique, dans la réalité la corrélation entre capital culturel et capital économique est plus forte que ce que le diagramme page 12 laisserait entendre. Il y aurait deux quadrants qui concentrerait une part de la population bien plus importante que les deux autres : celui en haut à droite (beaucoup de capital culturel et beaucoup de capital économique) et celui en bas à gauche (peu de capital culturel et peu de capital économique). Mais alors, si on suit mon raisonnement, les candidats aux discours libéraux-conservateurs et sociaux-libertaires devraient avoir des poids électoraux largement plus faibles que les libéraux-libertaires et sociaux-souverainistes. Or ce n’est pas véritablement le cas, Mélenchon et Fillon ayant notamment réussit à réunir chacun de l’ordre de 20% des suffrages en 2017. J’ai quelques idées en tête pour essayer d’interpréter ce genre de contradictions. Je n’ai pas cherché à cacher mes convictions, mais j’espère que ce texte et ces quelques schémas auront également éveillé l’intérêt de ceux qui ne partagent pas les mêmes idées. J’espère que j’aurais au moins réussi à les convaincre de la pertinence cet outil (cette idée de représenter les rapports de force selon deux axes et dont, encore une fois, je ne revendique pas la paternité), voir éventuellement que certains en fassent eux-même usage, se l’approprient afin d’analyser le paysage politique à leur façon.
.
.
[1] La page wikipédia Political Spectrum (en anglais) donne un bon aperçu de tout ce qui s’est fait sur la question :
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_spectrum
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chiquier_politique
Concernant le modèle de Thomas Guénolé, la principale différence est que dans celui-ci l’axe qui correspondrait à celui sur les questions de société se limite pour lui aux débats sur les minorités, ce qui me semble trop restrictif.
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/09/31001-20170109ARTFIG00262-vers-la-quadripolarisation-de-la-vie-politique-francaise.php
[2] On pourrait aussi estimer que lorsqu’il a été au pouvoir par le passé il a cautionné des politiques économiques très libérales, puisqu’il a toujours continué à soutenir Mitterrand même après le “tournant de la rigueur”, et que sous Jospin qu’il a accepté de rester dans un gouvernement qui privatisait massivement.
http://www.regards.fr/web/article/mitterrand-et-le-tournant-liberal-y-avait-il-une-alternative
https://www.francetvinfo.fr/economie/crise/crise-de-la-dette/privatisations-quel-premier-ministre-est-le-plus-gros-vendeur_713011.html
https://www.liberation.fr/portrait/2000/04/27/jean-luc-melenchon-48-ans-ex-grande-gueule-du-ps-rentre-dans-le-rang-avec-celui-de-ministre-delegue-_321446
[3] http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.ifop.com%2Fmedia
%2Fpoll%2F3749-1-study_file.pdf
[4] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Espace_social_de_
Bourdieu.svg
[5] http://www.histophilo.com/ideologie.php#Analyse_marxiste
[6] C’est notamment une thèse qui est défendue très régulièrement dans les articles du “Blog de Descartes”, un espace de débats animé par un ancien cadre du PCF qui, dans mon diagramme, se situerait très certainement dans le quadrant social-souverainiste. http://descartes-blog.fr
Sur cette question de la reproduction sociale, je copie ce passage extrait des échanges en commentaires (sous l’article du 16/09/18) et qui résume bien son analyse :
« Comment on a démantelé ces institutions ? Avec le discours le mieux intentionné qui soit. D’abord, il fallait éliminer la sélection sur des critères de mérite scolaire comme mode de promotion – ce qui laisse les coudées franches à d’autres modes de promotion fondés sur le « savoir être » et sur les réseaux familiaux. Ensuite, il fallait dévaloriser la connaissance elle-même, en encourageant chaque étudiant à être « fier » de ce qu’il est, ce qui élimine toute incitation à changer. Enfin, il fallait dévaloriser l’idée d’effort, de travail, de discipline, qui sont pourtant les seules armes qui permettent aux défavorisés d’échapper à leur condition. »
C’est sûrement un peu rapide pour vous convaincre, pour lire les arguments il faut se plonger dans les articles… Mais avant juste une remarque, pour pouvoir comprendre les analyses de ce blogueur. Il emploi fréquemment le terme “classes moyennes” mais pas vraiment au sens où on l’entend couramment. Il l’a définit de façon assez précise et a développé toute une théorie autour de cette notion, mais grosso-modo cela correspond à ce que l’on appelle couramment la “classe moyenne supérieure”, incluant principalement les “professions intellectuelles”, soit de l’ordre d’un tiers de la population. C’est plus ou moins équivalent à ce que je nomme, en la regroupant avec la classe bourgeoise, “classes supérieures” dans mon diagramme page 10. Le rapport de force se situerait donc entre cette alliance de classes et les “classes populaires”, correspondant au reste de la population.
Je laisse également le lien de cet interview du géographe Christophe Guilluy dont les analyses sont assez proches des siennes (bien que lui privilégie également le terme de “classes supérieures”) :
http://www.atlantico.fr/decryptage/christophe-guilluy-paradoxe-c-est-qu-aujourd-hui-sont-pauvres-qui-vont-demander-fin-etat-providence-christophe-guilluy-2823113.html
Ou téléchargez l’article en pdf ici (leur site bug pas mal je trouve)
[7] Un article qui me semble bien illustrer ce point de vue-là :
http://leclairon.tv/site/index.php/2015/12/07/la-fracture-francaise/
En réponse, j’ai envie de citer cet extrait d’une autre interview de C. Guilluy :
“Ces gens-là considèrent que le diagnostic des gens d’en bas n’est pas légitime. Ce qui est appelé « populisme ». Et cela est hyper fort dans les milieux académiques, et cela pèse énormément. On ne prend pas au sérieux ce que disent les gens. Et là, toute la machinerie se met en place. Parce que l’aveuglement face aux revendications des classes populaires se double d’une volonté de se protéger en ostracisant ces mêmes classes populaires. La posture de supériorité morale de la France d’en haut permet en réalité de disqualifier tout diagnostic social. La nouvelle bourgeoisie protège ainsi efficacement son modèle grâce à la posture antifasciste et antiraciste. L’antifascisme est devenu une arme de classe, car elle permet de dire que ce racontent les gens n’est de toute façon pas légitime puisque fasciste, puisque raciste.”
http://www.atlantico.fr/decryptage/christophe-guilluy-posture-anti-fasciste-superiorite-morale-france-en-haut-permet-en-realite-disqualifier-tout-diagnostic-social-3031677.html
[8] On évoque souvent l’idée qu’étant donné que la plupart des médias appartiennent à quelques milliardaires ceux-ci peuvent imposer aux équipes de rédaction de défendre une ligne qui aille dans le sens de leurs intérêts, mais personnellement j’ai tendance à penser que c’est un peu plus anecdotique.
Publié le 26/10/2018 | Mis à jour le 25/07/2020
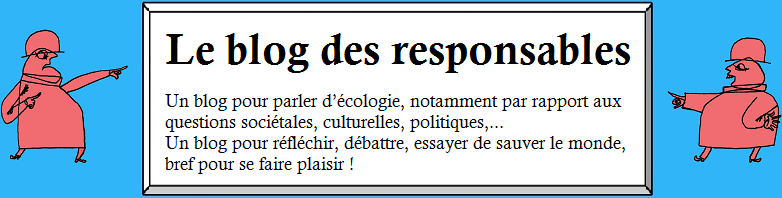
Bonjour
J’aime beaucoup cette approche qui est assez parlante. Bien sûr, il y a beaucoup de positionnements dont on peut discuter et c’est probablement un des intérêts de vos schémas.
Une petite remarque en particulier: même si il ne pèse plus bien lourd, il serait intéressant d’y ajouter le PCF qui est (je pense) pour une économie socialiste mais aussi pour une société assez normée (en tout cas pas libertaire). Cela explique les différences historiques avec le NPA mais aussi le difficile alliance avec FI.
Une suggestion: essayer de mettre les gouvernements actuels des principaux pays sur cette carte. Le cas de la Chine par exemple est assez complexe (mélange de libéralisme et de dirigisme).
J’aimeJ’aime
@Jean Chassaing
[Une petite remarque en particulier: même si il ne pèse plus bien lourd, il serait intéressant d’y ajouter le PCF]
Oui en effet, sur la matrice de 2022 il aurait été logique que je l’ajoute – sur celles de 2012 et 2017 il n’apparaît pas car j’y ai mis seulement les noms des mouvements qui avaient des candidats. Il doit s’agir d’un oubli, je le rajouterai à l’occasion!
[ qui est (je pense) pour une économie socialiste mais aussi pour une société assez normée (en tout cas pas libertaire). Cela explique les différences historiques avec le NPA mais aussi le difficile alliance avec FI.]
Je vais probablement le placer un peu comme sur celle de 2007, à cheval entre la moitié “libertaire” et la moitié “normée”. Pendant longtemps ils ont défendu des positions souverainistes et milité pour des institutions fortes, et comme cela correspondait aux attentes de la classe ouvrière ils avaient un poids électoral important – notamment si on regarde les premiers tours des législatives de 1945 à 1978 ils récoltent à chaque fois entre 19% et 26% des voix. Mais depuis les années 90, le passage de Robert Hue et les alliances gouvernementales avec le PS, à mon sens ils se sont largement décalés vers la droite de mon diagramme. Et je pense que c’est une des raisons qui expliquent la montée du FN ces dernières décennies, puisqu’il n’y avait plus aucun parti d’envergure dans ce quadrant social-souverainiste, et que du coup les classes populaires avaient le sentiment que plus personne ne se préoccupait véritablement de leurs problèmes. Donc finalement j’imagine qu’aujourd’hui au PCF il doit encore rester une petite base de militants aux convictions souverainistes et républicaines, mais ils sont probablement minoritaires et globalement la ligne du parti est quand même assez proche des autres mouvements de la gauche radicale.
[Une suggestion: essayer de mettre les gouvernements actuels des principaux pays sur cette carte. Le cas de la Chine par exemple est assez complexe (mélange de libéralisme et de dirigisme).]
En effet ça serait intéressant !
J’aimeJ’aime